Vous le savez, je suis très intéressé par les sujets de résilience communicationnelle. Dans cet article, intitulé « Communiquer en situation de rupture de la normalité », je souhaite explorer avec vous nos capacités à maintenir le lien et à transmettre de l’information lorsque les systèmes habituels disparaissent ou deviennent instables. Nous vivons dans un monde hyperconnecté, où Internet, les téléphones, la télévision et les réseaux sociaux donnent l’illusion que tout est toujours à portée de main. Mais que se passerait-il si demain, une rupture de cette normalité venait bouleverser nos moyens de communication ?
1. Quand la normalité se fragilise
Nous vivons dans une époque hyperconnectée. Internet, téléphones, messageries instantanées, réseaux sociaux, télévision : tous ces moyens nous donnent l’illusion d’un flux d’information permanent et infaillible. Mais que se passerait-il si demain, tout ou partie de cette connectivité venait à disparaître ?
Si nous ne pouvions plus contacter nos proches par téléphone ou par mail, consulter les actualités ou la météo, ou encore accéder aux réseaux sociaux, comment ferions-nous pour nous organiser, échanger, ou simplement rester informés ?
Cette réflexion n’est pas purement théorique. Les catastrophes naturelles, blackouts électriques, cyberattaques ou effondrements partiels des infrastructures nous montrent que la communication peut être fragile et vulnérable. Pour un individu isolé, il devient très difficile de maintenir un minimum de coordination. La communication, c’est avant tout une relation entre plusieurs personnes, idéalement au sein d’un groupe ou d’une communauté. La résilience communicationnelle est donc nécessairement collective.
2. La communication, colonne vertébrale de la résilience sociale
La communication ne se limite pas à transmettre de l’information. Elle entretient le tissu social : relations familiales, amicales, professionnelles, communautaires ou culturelles. Ces liens interdépendants sont essentiels à l’équilibre de l’individu et à la cohésion du groupe.
Préparer la résilience communicationnelle, c’est anticiper un éventuel chaos : définir des conduites à tenir, prévoir des points de ralliement, et organiser une continuité des échanges. Cela peut se traduire par une stratégie de voisinage, de clan, d’intérêt ou territoriale. Peu importe la forme, le principe fondamental reste : être plusieurs et coordonnés pour maintenir la communication, même dans des conditions difficiles.
3. Comprendre les ruptures de communication
Le concept de « rupture de la normalité » ne se limite pas à un effondrement global. Il s’agit de toute situation qui dégrade ou suspend les infrastructures de communication modernes. Les causes peuvent être multiples : catastrophes naturelles, accidents techniques, cyberattaques ou conflits localisés.
L’histoire récente et ancienne montre que la perte des moyens de communication affecte profondément la cohésion sociale et l’équilibre mental des individus. Même dans un pays comme la France, des zones rurales ou isolées pourraient devenir temporairement coupées du monde, et les conséquences seraient plus graves qu’on ne l’imagine.
Une approche systémique est donc nécessaire. Il ne s’agit plus seulement de protéger des réseaux ou des serveurs, mais de garantir la résilience des systèmes de communication dans leur ensemble, en incluant les humains, la logistique et les outils techniques.
4. Classification des moyens de communication
Pour anticiper et organiser une stratégie de communication, il est utile de comprendre et de classifier les moyens disponibles selon trois axes principaux :
- La direction du flux : unilatéral ou bilatéral.
- La synchronie : immédiat (temps réel) ou différé (asynchrone).
- Le niveau de résilience : capacité à fonctionner sans infrastructure, autonomie énergétique et robustesse.
4.1 Les moyens unilatéraux
Les moyens unilatéraux transmettent l’information dans une seule direction, d’un émetteur vers un ou plusieurs destinataires, sans interaction directe.
Les moyens immédiats incluent la radio ou la télévision, qui diffusent instantanément à large audience. Leur résilience dépend de l’infrastructure : une radio FM peut fonctionner avec des piles, tandis qu’un réseau Internet ou une télévision hertzienne dépendent d’un réseau électrique et d’un émetteur central. Ces moyens sont excellents pour l’alerte rapide, mais ne permettent pas de coordination directe.
Les moyens différés incluent les affichages publics, les registres locaux, les messages papier ou les pigeons voyageurs. Leur principal avantage est l’autonomie et la persistance dans le temps. Même sans énergie ni réseau, l’information est disponible, visible et consultable. Ces systèmes sont extrêmement robustes et restent une solution viable pour la diffusion locale ou régionale en situation de crise.
4.2 Les moyens bilatéraux
Les moyens bilatéraux permettent une interaction réelle entre émetteur et récepteur. Ils sont essentiels pour la coordination, la prise de décision et la réactivité.
-
-
- Les moyens synchrones sont ceux qui fonctionnent en temps réel. Les talkies-walkies, radios amateurs ou certaines communications Mesh locales en font partie. Ils permettent un échange immédiat, utile pour coordonner des équipes sur le terrain ou gérer des situations critiques. Leur résilience dépend de la topologie du réseau et de la disponibilité énergétique, mais ces moyens restent largement autonomes comparés aux systèmes centralisés.
- Les moyens asynchrones fonctionnent avec un décalage temporel. Les réseaux Mesh « store-and-forward » (comme Meshtastic ou Reticulum) permettent d’envoyer des messages même si certains relais ne sont pas immédiatement disponibles. La résilience de ces systèmes est très élevée, car ils ne dépendent pas d’une infrastructure centralisée et peuvent couvrir de grandes distances de manière progressive.
-
4.3 Les moyens hybrides et maillés
Certaines solutions combinent diffusion unilatérale et interaction bilatérale. Les réseaux Mesh dynamiques, comme Meshtastic, MeshCore ou GoTenna, offrent des échanges semi-synchrones. Chaque nœud retransmet les messages vers le reste du réseau, ce qui permet de créer un système autonome, redondant et extensible.
Ces systèmes incarnent la résilience maximale : ils sont peu énergivores, indépendants de l’Internet, et peuvent être déployés sur des territoires larges pour maintenir la communication même en situation de rupture totale.
5. Comment mettre en œuvre une résilience communicationnelle
Construire une résilience efficace nécessite plusieurs axes d’action :
- Mettre en œuvre des canaux vocaux fiables : radios PMR, CB, talkies-walkies ou radios amateurs.
- Assurer l’autonomie énergétique : batteries, panneaux solaires, génératrice, gestion rationnelle de l’énergie.
- Organiser la coordination : rendez-vous radio réguliers, points d’information publics physiques ou numériques.
- Déployer des réseaux maillés : réseaux Mesh locaux et interconnectés pour étendre la portée et la redondance.
- Diffuser la connaissance : mini-serveurs, applications pair-à-pair et bases documentaires locales pour partager les informations et solutions pratiques.
Le but est de créer une toile de communication robuste et décentralisée, capable de résister aux ruptures et de maintenir un minimum de coordination sociale et opérationnelle.
6. Conclusion : anticiper avant la rupture
La résilience communicationnelle ne se décrète pas au moment de la crise : elle se prépare, se teste et se partage. Certains outils sont simples et accessibles : affichages, radio FM, PMR, Mesh. D’autres nécessitent une organisation collective et des compétences techniques, mais tous sont complémentaires.
Communiquer, c’est à la fois émettre, recevoir et interagir. C’est la clé de la résilience individuelle et collective. Et c’est seulement en anticipant ces ruptures que nous pouvons espérer maintenir nos capacités d’organisation et notre cohésion sociale.
7. Construire ses compétences pour une résilience réelle
La résilience communicationnelle ne se limite pas à disposer de matériel ou de dispositifs redondants. Elle repose avant tout sur les connaissances et compétences de chacun. Savoir utiliser une radio, comprendre les réseaux maillés, configurer un transceiver, ou organiser un plan de communication clanique, c’est préparer la capacité à agir et à maintenir le lien en situation de rupture.
En développant ces compétences, chaque lecteur peut passer du statut d’observateur à celui d’acteur, capable de maintenir des flux d’information, de coordonner des équipes ou de créer un réseau autonome et résilient.
La résilience communicationnelle n’est donc pas seulement un enjeu technique : elle est humaine, collective et stratégique. Le savoir et la pratique deviennent vos meilleurs outils pour ne pas subir la rupture mais pour la gérer.
Le blog La Résilience.fr accompagne cette démarche en proposant des articles détaillés, pratiques et progressifs, permettant à chacun de construire sa stratégie personnelle et collective. Parmi ces ressources :
Les connaissances transversales
- Le mythe de la radio d’urgence dynamo — 20 octobre 2025
- Booster vos talkies-walkies — 1 septembre 2025
- Les Balises de Détresse — 8 mai 2024
- Kit numérique d’urgence d’un survivaliste — 17 octobre 2021
- Portatif DMR Retevis RT82 — 16 décembre 2020
- QSO – QTH et QRK – Survivaliste QRV ? — 2 février 2020
- La Réglementation PMR446 et CB — 18 janvier 2020
- Guide d’initiation à la technique radio — 10 janvier 2020
- Réflexion sur l’usage CTCSS — 8 janvier 2020
- Notions de propagation d’ondes — 28 décembre 2019
- Plan Radio des Fréquences Résilientes Françaises — 28 septembre 2019
- La radiocommunication Survivaliste en France — 20 septembre 2019
- Réseaux de communication et Cyber-Résilience — 27 janvier 2019
La station UHF/VHF QYT KT8900D
- Alimentation à découpage pour le QYT KT-8900D — 28 février 2021
- Configuration USB du QYT KT8900D — 29 janvier 2021
- La station mobile QYT KT-8900D — 18 janvier 2021
Le Talkie-Walkie TYT UV88
- Le TYT UV88 augmenté d’une batterie 3200 mAh USB-C — 29 août 2025
- Configuration USB du TYT TH-UV88 — 10 janvier 2021
- TYT TH-UV88 versus Baofeng UV-5R — 28 décembre 2020
Les réseaux maillés Meshtastic
- Meshtastic vs Gaulix [4/4] — 5 octobre 2025
- Meshtastic – usages avancés [3/4] — 17 septembre 2025
- Meshtastic – monter son premier réseau [2/4] — 11 septembre 2025
- Journée de crise avec le réseau Meshtastic — 10 septembre 2025
- Meshtastic – un réseau autonome et résilient [1/4] — 31 août 2025
Le Talkie-Walkie BaoFeng UV-5R et Mini
- Baofeng UV-5R Mini – Configuration — 2 novembre 2025
- Que vaut le Baofeng UV-5R Mini ? — 1 novembre 2025
- BaoFeng UV-5R – Firmwares et Recovery — 29 octobre 2019
- Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Baofeng UV-5R — 29 septembre 2019
- BaoFeng UV-5R et le répéteur mobile Surecom SR112 — 31 août 2019
- BaoFeng UV-5R – Les relais — 18 août 2019
- BaoFeng UV-5R – Synthèse des fréquences utiles — 17 février 2019
- BaoFeng UV-5R – Usages avancés – Codage CTCSS — 10 février 2019
- BaoFeng UV-5R – Prise en main et configuration — 4 février 2019

Je m’appelle Sébastien. Sans jugement ou catégorisation, je ne m’identifie pas plus particulièrement aux « Survivalistes », « Preppers », « Décroissant », (…) qui ont cependant le mérite de mettre en lumière des sujets et connaissances malgré tout. Je me reconnais plutôt comme un « Résilient ». En tant que père de famille, je développe une approche modéré, structurée et éducative avec une forte envie d’apprendre et transmettre. En savoir plus.
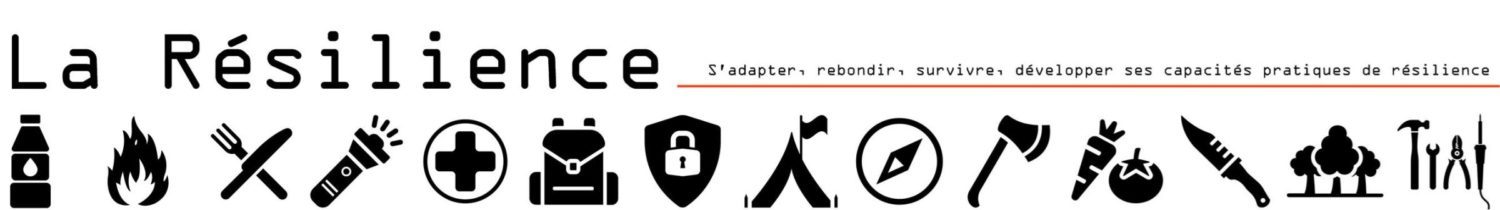





Encore un excellent article. Très développé. Merci
Merci complet et didactique.
Je vais me pencher sur le sujet radio que je ne connais plus….
Super article. Clair et agrémenté. Merci ! 🙂