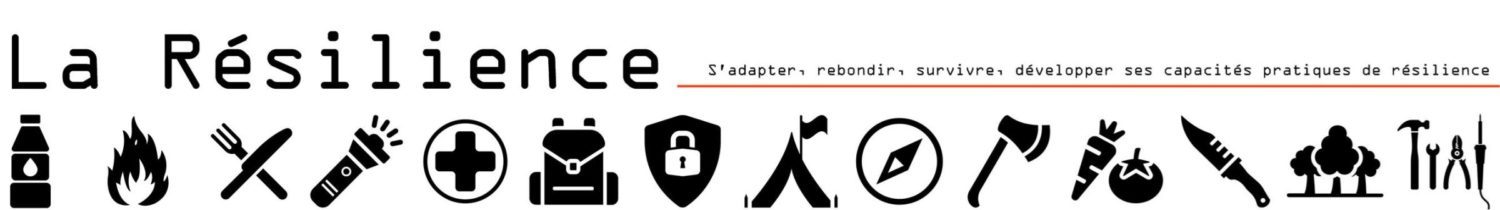Les cordages, sangles et ficelous sont omniprésents dans les activités de terrain. On les utilise pour attacher, tirer, sécuriser, hisser, abriter… et pourtant, leur rangement reste souvent négligé. Un cordage bien rangé ne s’emmêle pas, ne vrille pas et s’use moins vite. Un mauvais rangement, au contraire, peut le fragiliser, le rendre inutilisable, voire dangereux en situation d’urgence.
Cet article propose un tour complet des méthodes de rangement du cordage, des contextes où elles s’appliquent, et des bonnes pratiques d’entretien pour prolonger la durée de vie de vos lignes, sangles et ficelous.
1. Love, lovage et autres méthodes de rangement
Avant d’entrer dans le détail, clarifions la terminologie.
👉 Lover est le verbe : cela signifie enrouler un cordage sur lui-même selon une méthode ordonnée.
👉 Une love est le nom donné à la forme obtenue, c’est-à-dire le paquet de boucles qui résulte de cette opération.
L’art de lover une corde dépend de son usage, de sa longueur et du contexte dans lequel on la manipule : sur un bateau, en montagne, au bivouac ou dans un atelier. Voici les principales méthodes, détaillées et comparées.
1.1 La love en rond (ou love classique)
C’est la méthode la plus instinctive : on enroule la corde en boucles concentriques, à plat sur le sol ou dans la main. Cette technique est courante pour les cordages courts, les haubans ou les ficelous.
-
-
- Principe : On forme une première boucle, puis on enroule le brin restant autour de celle-ci, en conservant un diamètre constant. À la fin, on bloque la love avec quelques tours du brin libre ou un petit nœud.
- Avantages : Rapide et simple à réaliser. Peu encombrant pour les petits cordages. Idéal pour du rangement temporaire dans un atelier, un garage ou sur un bateau.
- Inconvénients : Sur de longues cordes, cette méthode crée des torsions et des vrilles. Le déploiement est lent et peut engendrer des nœuds.
- Utilisations typiques : Rangement de cordelettes courtes, bricolage, nautisme, jardin, haubans de tarp.
-
1.2 La love en huit
Méthode phare des grimpeurs et des marins, elle consiste à former des boucles alternées en forme de huit, ce qui évite les torsions internes.
-
- Principe : On alterne les boucles de part et d’autre de la main ou d’un support, souvent la cuisse ou une sangle, de manière à ce que chaque brin se croise. En fin de lovage, on termine par une clé de blocage (demi-nœud ou ganse) pour fixer l’ensemble.
- Avantages : Aucune torsion, la corde se déploie sans vrille. Adaptée aux cordes dynamiques comme celles d’escalade ou de secours. Permet un rangement propre et rapide, même en hauteur.
- Inconvénients : Légèrement plus long à apprendre. Prend un peu plus de place qu’une love en rond.
- Utilisations typiques : Escalade, alpinisme, canyoning, secours, spéléologie, nautisme (cordages de manœuvre).
1.3 La love papillon (ou love de montagne)
Méthode d’alpiniste par excellence, elle permet de porter la corde sur soi et de la déployer rapidement sans emmêlement. C’est la technique la plus polyvalente pour une corde de progression.
-
-
- Principe : On alterne les boucles sur la main et l’avant-bras, ou autour du coude et de la main, en formant une série de brins plats. En fin de lovage, on réalise une clé de blocage centrale en passant le brin libre plusieurs fois autour du torse de la love, puis on fait passer l’extrémité dans une ganse pour verrouiller. La corde peut alors être passée autour du cou ou en bandoulière.
- Avantages : Transport confortable. Déploiement fluide et sans vrille. Permet d’avoir la corde prête à l’emploi.
- Inconvénients : Demande un peu d’habitude. Moins compacte pour le rangement dans un sac.
- Utilisations typiques : Alpinisme, escalade, spéléologie, progression sur glacier, secours en montagne. (Le lovage en bandoulière est une variante plus lâche du papillon, souvent utilisée en progression glaciaire.)
-
1.4 La méthode des ganses en chaîne (ou chaînette)
Utilisée pour les sangles, longes, ficelous ou cordelettes fines, cette méthode consiste à créer une succession de boucles passées les unes dans les autres, comme une chaînette de crochet.
-
-
- Principe : On fait une première boucle, puis on tire une nouvelle boucle à travers la précédente, et ainsi de suite, jusqu’à la fin du brin. La dernière boucle est bloquée avec un petit nœud ou en repassant le brin libre.
- Avantages : Rangement ultra compact, aucun nœud ni vrillage, se déploie sans s’emmêler. Idéal pour les longueurs courtes et moyennes.
- Inconvénients : Peu adaptée aux très longues cordes. Nécessite un peu de pratique pour garder une tension régulière.
- Utilisations typiques : Sangles de hamac, haubans de tarp, ficelous d’autobloquant, petits cordages de bivouac ou de secours.
-
1.5 Les oreilles de cocker
Appelée aussi double boucle de stockage, cette méthode est très utilisée dans le nautisme et les travaux sur corde. Elle permet de suspendre proprement un cordage tout en le gardant immédiatement disponible.
-
-
- Principe : On forme deux grandes boucles égales que l’on replie sur elles-mêmes en alternant droite et gauche, les fameuses « oreilles ». On termine en enroulant le brin libre autour du centre pour former une tête compacte, puis on bloque la fin sous un tour. Le tout peut être suspendu à un mousqueton, une bitte ou un crochet.
- Avantages : Permet une mise à disposition immédiate. Évite les torsions. Idéale pour cordages de manœuvre, cordes de sécurité ou lignes d’amarrage.
- Inconvénients : Nécessite un peu d’habitude pour équilibrer les boucles. Peut être encombrante dans un sac.
- Utilisations typiques : Nautisme, secours, spéléologie, ateliers techniques.
-
1.6 Le lovage en flocon (flake coil)
Méthode moderne et fluide, le lovage en flocon consiste à disposer la corde à plat dans un sac ou sur le sol, boucle par boucle. Chaque spire repose librement sur la précédente, sans torsion.
-
-
- Avantages : Aucun tirage ni nœud au déploiement. Idéal pour les cordes dynamiques utilisées en escalade indoor, en secours ou sur les bateaux.
- Inconvénients : Nécessite un support propre et dégagé. Ne convient pas au transport sur soi.
- Utilisations typiques : Escalade en salle, cordages de secours, nautisme.
-
1.7 Le lovage suspendu en couronne
Méthode utilisée sur les bateaux, dans les ports, hangars et chantiers navals. Elle consiste à suspendre la corde en boucles régulières, accrochées à un taquet, un crochet ou un clou mural.
-
-
- Avantages : Permet un rangement propre, ventilé et esthétique. Empêche l’humidité de s’accumuler. Pratique pour les cordes lourdes ou peu utilisées.
- Inconvénients : Stationnaire et non transportable. Implique un point d’accrochage fixe.
- Utilisations typiques : Nautisme, chantiers navals, entrepôts, ateliers.
-
1.8 Le bobinage sur lui-même
C’est la méthode traditionnelle pour les sangles plates, longes ou ficelous de diamètre moyen. Elle consiste à rouler le brin sur lui-même en spirale, de manière à former une pelote compacte.
-
-
- Principe : On forme une première boucle serrée, puis on continue à enrouler le reste du brin autour du centre. Une fois la longueur terminée, on coince le dernier segment sous un tour précédent ou on le bloque par une mini ganse.
- Avantages : Rangement stable et très compact. Protège la sangle ou le ficelou des torsions. Rapide à réaliser.
- Inconvénients : Peu pratique pour des cordes longues. Nécessite une tension régulière pour ne pas se défaire.
- Utilisations typiques : Sangles de sécurité, longes, sangles d’amarrage, ficelous d’alpinisme, de secours ou de bushcraft, petites cordelettes de haubanage.
-
1.9 L’usage des dévidoirs
Les dévidoirs sont très utiles pour les cordes de grande longueur, notamment en spéléologie, en secours ou en usage nautique. Ils permettent un déploiement fluide sans torsion ni nœud, tout en facilitant le rangement.
-
-
- Principe : Le lovage s’effectue directement sur le dévidoir par enroulement régulier, en respectant le sens naturel de la corde. Certains modèles intègrent un système de frein ou un guide-corde pour maintenir une tension constante.
- Avantages : Gain de temps au déploiement. Évite les emmêlements. Protège la corde de la saleté et de l’humidité.
- Inconvénients : Encombrant pour les petites longueurs. Nécessite un matériel dédié.
- Utilisations typiques : Spéléologie, secours, voile, plongée, travaux sur corde.
-
2. Contextes et logiques d’usage
Chaque discipline a développé ses techniques selon ses besoins spécifiques.
-
- En alpinisme, escalade et spéléologie, le lovage en huit ou papillon garantit un déploiement immédiat et évite les vrilles.
- Dans le secours et les travaux sur corde, la rigueur et la rapidité priment. Les cordes sont lovées méthodiquement dans des sacs à corde pour être immédiatement opérationnelles.
- En nautisme, le rangement doit être fonctionnel et accessible. Les marins privilégient les enroulements plats ou suspendus, ainsi que les dévidoirs pour faciliter le déploiement rapide des cordages sur le pont.
- Dans le bushcraft et le bivouac, les paracordes, haubans et ficelous sont enchaînés ou bobinés sur eux-mêmes pour un rangement compact et transportable.
- Pour la plongée et l’exploration, les cordelettes doivent se dérouler sans résistance ni nœud, ce qui explique le recours au bobinage serré ou aux dévidoirs spécialisés.
3. Entretien et durabilité des cordages
Le rangement ne suffit pas : un cordage mal entretenu est un cordage fragilisé. Les matériaux modernes comme le nylon, le polyester ou le Dyneema sont résistants, mais sensibles à plusieurs facteurs.
☀️ Lumière et UV
Les rayons ultraviolets dégradent progressivement les fibres synthétiques. Il est donc recommandé d’éviter le séchage prolongé au soleil et de stocker les cordes à l’abri de la lumière directe. L’usage de sacs opaques ou de housses est particulièrement conseillé pour les cordes d’escalade ou de voile.
💧 Humidité et moisissures
Une corde mouillée perd de sa résistance et peut développer des moisissures si elle reste confinée. Il faut toujours laisser sécher à l’air libre, à l’ombre, et ne jamais enfermer la corde humide dans un sac. Évitez également le séchage près d’une flamme ou d’un radiateur, au risque de faire fondre ou déformer les fibres.
🧼 Nettoyage et lavage
Le lavage peut se faire en machine à laver à froid (30 °C maximum), dans une housse en filet et sans essorage violent. Il est conseillé d’utiliser un détergent doux comme du savon de Marseille ou un produit spécifique pour cordes. La javel et les assouplissants sont à proscrire. Après lavage, rincer abondamment et laisser sécher naturellement.
⚙️ Usure mécanique
Il est important de vérifier régulièrement les zones de frottement, comme les gaines abîmées ou les torons écrasés, les nœuds persistants ou sections rigides, ainsi que les signes de fusion ou de peluchage.
🧳 Stockage et roulage
Toujours lover correctement avant de ranger. Éviter les pliages serrés et ranger dans un sac ventilé à température modérée. Il est utile d’étiqueter les cordes selon leur usage : escalade, voile, bricolage, secours, etc.
4. En conclusion
Le rangement du cordage est bien plus qu’un geste d’ordre : c’est un véritable savoir-faire. Il traduit la rigueur et la préparation de celui qui pratique. Apprendre à lover, enchaîner, bobiner et entretenir, c’est prolonger la vie de son matériel et éviter les mauvaises surprises en situation réelle.
Un cordage bien rangé est un compagnon prêt à servir, que ce soit pour grimper, amarrer, tendre un abri ou secourir.
5. Quelques articles connexes sur le blog
- La paracord 550, est-ce un mythe ?.
- Les compétences cordiste et les équipements
- La corde, un outil élémentaire et incontournable ?
- Kit réchappe de fond de sac
- Les nœuds, compétence essentielle de résilience

Je m’appelle Sébastien. Sans jugement ou catégorisation, je ne m’identifie pas plus particulièrement aux « Survivalistes », « Preppers », « Décroissant », (…) qui ont cependant le mérite de mettre en lumière des sujets et connaissances malgré tout. Je me reconnais plutôt comme un « Résilient ». En tant que père de famille, je développe une approche modéré, structurée et éducative avec une forte envie d’apprendre et transmettre. En savoir plus.