Dans nos sociétés modernes, chaque activité repose sur des infrastructures centralisées : électricité, Internet, satellites, serveurs cloud et télécommunications. Cette dépendance invisible devient critique dès qu’elle se rompt. Pour nous les résilients, comprendre cette fragilité n’est pas une curiosité : c’est une nécessité.
Pourquoi préparer une stratégie de continuité et défense numérique off‑grid ?
1. Scénarios de rupture dominants
Parmi toutes les ruptures possibles, trois scénarios dominent par probabilité et impact :
1.1 Blackout généralisé
Le blackout généralisé est de loin le plus probable. Qu’il soit causé par une panne technique, une tempête ou un sabotage, il paralyse immédiatement tous les systèmes connectés : communications, pompes à carburant, distribution d’eau, services essentiels. C’est le scénario de référence, celui sur lequel toutes les stratégies de continuité doivent se fonder.
1.2 Cyberattaques ciblées
Les cyberattaques sur les infrastructures critiques vont bien au-delà de la simple destruction matérielle. Elles peuvent prendre le contrôle des systèmes, perturber les chaînes de production et de distribution, manipuler les données ou désorganiser les communications officielles. Ces attaques, souvent coordonnées et discrètes, provoquent des désordres durables et des conséquences indirectes : pénuries locales, chaos logistique, perturbation de l’approvisionnement en énergie, en eau ou en carburant, et impact sur la sécurité des populations. Leur objectif est stratégique : en créant ce chaos, elles forcent la communauté à se défendre ou à réagir, soulignant l’importance d’un dispositif capable de maintenir la communication et coordonner les fonctions vitales.
1.3 Crises énergétiques prolongées
Les crises énergétiques prolongées peuvent résulter de pénuries de carburant, de ruptures d’importations, de surcharge des réseaux électriques, de conflits ou de désorganisation logistique. Ces facteurs entraînent une réduction progressive de la production et de la distribution d’énergie, perturbant les transports et l’approvisionnement des commerces. Les supermarchés voient leurs rayons se vider, et des crises alimentaires locales peuvent apparaître, générant une incertitude quotidienne. Cette lente dégradation accentue la vulnérabilité des communautés et met en évidence la nécessité d’un module de continuité numérique, capable de maintenir communication, coordination et accès aux informations vitales malgré la raréfaction des ressources.
2. Définir sa stratégie off‑grid
Face à ces risques, dépendre des réseaux classiques est un luxe que personne ne peut se permettre. Il devient essentiel de définir sa propre stratégie et potentiellement constituer un module de continuité numérique : un dispositif compact, autonome et résilient, capable de maintenir communication, stockage d’informations vitales et coordination locale, même lorsque le reste du monde est plongé dans le noir.
2.1 Cynisme et réalisme
Certains pourraient se demander : est-ce vraiment nécessaire de rétablir des infrastructures numériques ? Un soi-disant loup solitaire, persuadé d’être totalement autonome, pourrait penser pouvoir se passer de communications.
C’est logique… jusqu’au moment où une situation critique survient. Une hémorragie bridée par un garrot tourniquet ? Pas de SAMU à appeler, pas d’urgence à rejoindre, pas de spécialiste pour guider la suite. Et quand il regarde son propre bras ou sa jambe, il pourrait tenter… de la mettre dans la cheminée pour « cautériser » l’hémorragie !
L’ironie est cruelle, mais le message est clair : aucun survivant, même le plus autonome, ne peut ignorer la nécessité d’un réseau minimal de communication et de coordination. Le module de continuité n’est pas un gadget ; c’est le filet de sécurité qui sauve là où compétence et rapidité font toute la différence.
2.2. La résilience communicationnelle
Comme exploré dans l’article Communiquer en situation de rupture de la normalité, la communication est la colonne vertébrale de la résilience sociale. Dans un contexte off‑grid, maintenir le lien entre individus et groupes est tout aussi vital que protéger l’énergie, l’eau et les ressources alimentaires. Les systèmes modernes comme les téléphones, Internet et les réseaux sociaux créent l’illusion d’une disponibilité permanente, mais dès qu’une rupture survient, coordination, information et prise de décision sont menacées. Dans ce précédent article je vous ai proposé en annexe quelques pistes et compétences techniques à développer. Nous allons maintenant réfléchir à ce que nous devrions mettre en place comme stratégie de continuité et défense numérique.
2.3 Préparation aux crises
Si la résilience communicationnelle pose les bases, la préparation aux crises en est la mise en œuvre opérationnelle. Construire un module de continuité et de défense numérique off-grid, ce n’est pas empiler du matériel, c’est bâtir une doctrine d’autonomie fonctionnelle. L’enjeu : assurer la pérennité de l’information, la sécurité des échanges et la coordination locale quand les réseaux tombent.
La question n’est pas de savoir si une rupture aura lieu, mais quand et sous quelle forme. Préparer un module, c’est accepter cette réalité et intégrer le numérique dans la logique de continuité essentiel à une organisation familiale, clanique ou communautaire. Sans moyen de transmettre ni de conserver l’information, l’organisation s’effondre : les savoirs se perdent, les équipes s’isolent, la coordination disparaît.
Avant de songer à construire un module de continuité numérique, il faut d’abord se poser les bonnes questions pour comprendre ce qu’on veut vraiment préserver, à quel prix et dans son propre contexte :
-
-
- Ai-je le temps de me préparer sérieusement ?
- Ai-je les compétences techniques de base pour monter, configurer et entretenir un système autonome ?
- Suis-je prêt à apprendre, ou à m’entourer de personnes capables de le faire ?
- Quelles informations ou fonctions sont réellement vitales à maintenir en cas de rupture ?
- La communication ? La coordination d’un groupe ? L’accès à des cartes, des protocoles ou des données médicales ?
- Mon matériel est-il robuste, économe, et facilement réparable ?
- Ai-je besoin d’un plan/protocole de continuité numérique ?
- Ai-je besoin de mettre en œuvre une défense numérique ?
-
Et surtout : ce module, je veux le construire pour moi seul dans l’idée peut-être d’assurer ma survie individuelle, ou pour renforcer un maillage collectif et constructif ?
Ces questions ne sont pas accessoires. Elles séparent la simple curiosité technologique de la vraie démarche de résilience. Y répondre honnêtement, c’est déjà commencer à bâtir une défense numérique ancrée dans le réel.
Pour ma part, je construis depuis plusieurs années une démarche de développement personnel et technique visant à mieux comprendre les enjeux humains et technologiques liés à la continuité numérique. J’y consacre régulièrement du temps pour acquérir de nouvelles compétences dans le champ de ce que j’appelle la résilience numérique localisée — un concept que je développe autour de la continuité des communications et des outils numériques en contexte dégradé.
Cette approche intègre naturellement les principes d’autodéfense numérique (voir ci-dessous), mais aussi des compétences concrètes en radio analogique et numérique : VHF/UHF, transmissions de données en HF, réseaux ISM/IoT, ou encore Meshtastic pour le maillage local. L’objectif n’est pas de devenir un expert isolé, mais de comprendre et maîtriser les bases essentielles pour maintenir une autonomie numérique minimale, même hors réseau (Kit numérique d’urgence d’un survivaliste).
Le rôle du module de continuité et défense numérique est de garantir un accès constant aux informations vitales, faciliter les échanges bilatéraux et permettre des décisions rapides et éclairées. En combinant moyens synchrones (talkies-walkies, radios amateurs, Mesh WiFi/LoRa) et asynchrones (« store-and-forward » comme Reticulum ou Meshtastic), le module assure que la communication continue, même lorsque l’infrastructure classique disparaît, traduisant la résilience communicationnelle en action concrète.
2.4 Concrètement
Ne comptez pas sur moi pour vous faire une shopping list. Dans le cas présent, c’est une stratégie que vous devez construire et définir par vous-même en fonction de votre contexte de vie. Un module de continuité numérique ne se résume pas à un simple ensemble d’appareils. C’est une infrastructure miniature, pensée pour tenir, s’adapter et communiquer dans un environnement dégradé.
-
- Isolable : le module doit pouvoir fonctionner de manière totalement autonome, avec ses propres sources d’énergie et de données.
- Sécure : il protège les communications, chiffre les informations sensibles et cloisonne les accès selon les rôles et les besoins.
- Interconnectable : il doit pouvoir échanger avec d’autres modules ou réseaux locaux par radio, LoRa ou tout protocole maillé. Cette capacité d’interconnexion garantit la circulation minimale de l’information, même en cas de rupture prolongée.
- Redondant : il comprend au moins une copie physique et hors ligne des éléments essentiels, comme les cartes, les contacts, les documents, les protocoles ou les journaux techniques. La redondance assure la durabilité.
L’approche est progressive. On commence avec des outils simples, robustes et accessibles tels qu’une radio, un Raspberry Pi ou des clés USB chiffrées. Puis on évolue vers des architectures plus complexes, comme les nœuds mesh, les relais d’information ou les serveurs locaux. Chaque étape renforce la capacité collective à rester connectée dans un monde déconnecté.
Le module n’est pas seulement une boîte d’outils. C’est une véritable cellule de résilience numérique territoriale, capable de protéger la donnée, de maintenir le lien social et de relayer les informations critiques lorsque tout le reste faiblit.
Il constitue la première pierre d’une défense numérique décentralisée, une réponse concrète aux dépendances systémiques et à la fragilité de nos infrastructures modernes. Penser, construire et partager ces modules revient à amorcer un mouvement collectif vers une autonomie numérique raisonnée, au service des territoires et des communautés qui les habitent.
Concrètement, le blog et ses différents articles vous apporte une matière conséquente de réflexions et de connaissances qu’il vous faut transformer en compétences. Rome ne s’est pas fait en un jour, alors plus tard vous vous y intéresserez, plus tard vous serez prêt. Premier conseil, lire le Guide d’autodéfense numérique.
3. Le guide d’autodéfense numérique
Dans un monde saturé d’écrans, d’algorithmes et de connexions permanentes, la dépendance numérique est devenue la norme. Chaque clic, chaque recherche, chaque message laisse une trace exploitable. Le Guide d’autodéfense numérique est une réponse lucide à cette réalité : un manuel d’émancipation pour celles et ceux qui refusent la surveillance et la passivité technologique.
Écrit collectivement par des acteurs du logiciel libre, des techniciens, des militants et des citoyens, cet ouvrage dense (près de 600 pages) nous apprend à comprendre, protéger et reprendre le contrôle de nos outils numériques. Il ne s’agit pas de fuir la technologie, mais de la dompter : savoir ce que nos appareils savent de nous, maîtriser les traces que nous laissons, chiffrer nos échanges, cloisonner nos usages, et bâtir une sécurité adaptée à nos réalités.
Cette sixième édition, entièrement actualisée en 2023, fait le point sur les nouveaux risques, les évolutions des systèmes libres et les pratiques de sécurité numérique modernes. Elle mêle théorie et pratique : de la configuration d’un ordinateur à la gestion d’une messagerie sécurisée, en passant par la protection des données sur le terrain. Chaque chapitre aide à évaluer les menaces selon son contexte — qu’on soit simple utilisateur, créateur de contenu, administrateur réseau ou membre d’un collectif local.
Le guide ne prône pas la paranoïa, mais la réduction des risques. Comme dans toute démarche de résilience, il s’agit d’observer, comprendre, puis agir de façon proportionnée. Il invite à reconstruire des infrastructures de communication locales et sûres, à s’émanciper des solutions propriétaires, et à faire des outils numériques des alliés plutôt que des menaces.
Sous licence libre, l’ouvrage peut être téléchargé, adapté, imprimé et partagé librement. Il s’adresse à tous ceux qui veulent apprendre à vivre connectés sans se soumettre : résilients, makers, explorateurs, éducateurs, journalistes, familles ou simples citoyens souhaitant protéger leur autonomie.
Le Guide d’autodéfense numérique n’est pas un livre de geeks : c’est une trousse de survie numérique. Un compagnon à garder à portée de main, pour reprendre le contrôle, comprendre les enjeux invisibles du monde connecté, et faire du numérique un espace de liberté retrouvée.
4. Les connaissances annexes sur le blog
- Communiquer en situation de rupture de la normalité — 21 octobre 2025
- Le mythe de la radio d’urgence dynamo — 20 octobre 2025
- Kit numérique d’urgence d’un survivaliste — 17 octobre 2021
- Guide d’initiation à la technique radio — 10 janvier 2020
- Plan Radio des Fréquences Résilientes Françaises — 28 septembre 2019
- La résilience numérique localisée — 16 juillet 2019
- Réseaux de communication et Cyber-Résilience — 27 janvier 2019

Je m’appelle Sébastien. Sans jugement ou catégorisation, je ne m’identifie pas plus particulièrement aux « Survivalistes », « Preppers », « Décroissant », (…) qui ont cependant le mérite de mettre en lumière des sujets et connaissances malgré tout. Je me reconnais plutôt comme un « Résilient ». En tant que père de famille, je développe une approche modéré, structurée et éducative avec une forte envie d’apprendre et transmettre. En savoir plus.
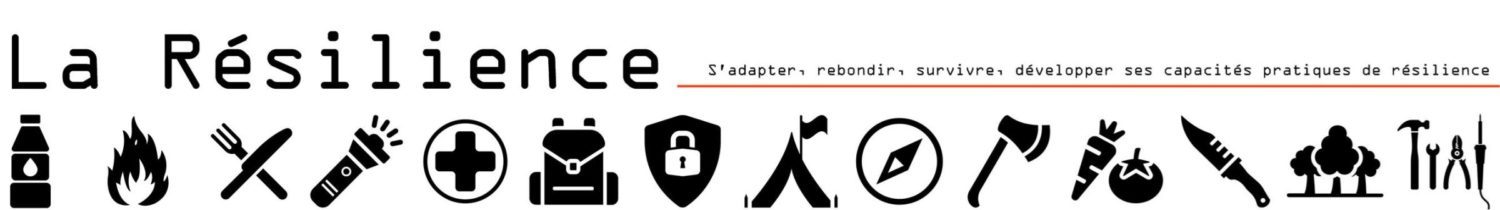





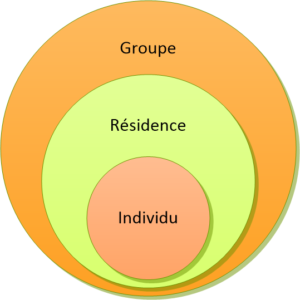


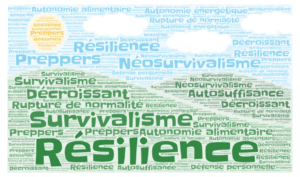

Une fois de plus, que d’informatio …
J’ai encore pas mal de « taf » côté com’.
Merci pour ce top article 🙂