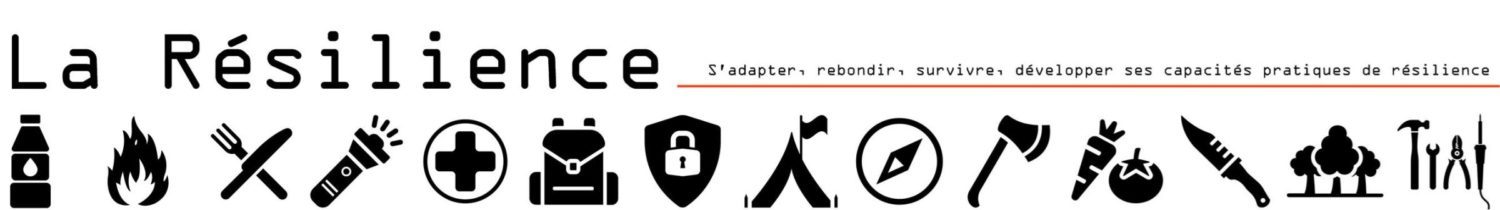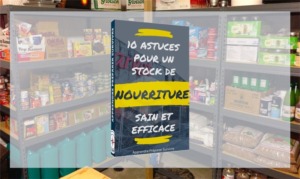Stages de survie en France : entre engouement populaire et vide juridique
Les stages de survie connaissent un essor spectaculaire en France. De plus en plus de personnes se tournent vers ces formations pour se reconnecter à la nature, développer leur autonomie ou simplement vivre une expérience hors du commun. Mais derrière cet engouement se cachent des enjeux de sécurité, de professionnalisation et de reconnaissance légale.
L’élément déclencheur : un drame qui a interpellé le Sénat
En août 2020, un tragique accident a secoué le monde des stages de survie : un jeune homme de 25 ans est décédé lors d’un stage dans une forêt du Morbihan après avoir ingéré une plante toxique, l’œnanthe safranée, cousine de la ciguë. Cet événement a conduit le sénateur Yannick Vaugrenard à interroger le gouvernement sur l’absence de réglementation encadrant ces pratiques. Sénat
Pourquoi un tel engouement pour les stages de survie ?
Plusieurs facteurs expliquent l’intérêt croissant du public pour ces formations :
-
- Retour à la nature : dans un monde hyperconnecté, beaucoup recherchent une expérience de déconnexion.
- Quête de résilience personnelle : face aux crises sanitaires, économiques ou climatiques, la société prend conscience de sa vulnérabilité.
- Aventure et dépassement de soi : pour certains, c’est un défi physique et psychologique.
- Mode et médiatisation : la popularité des émissions télévisées (Koh-Lanta, Man vs Wild…) a démocratisé l’image du stage de survie.
- Dimension collective : loin d’être une démarche solitaire, ces stages créent du lien.
Survivologie : une approche pédagogique fondée par David Manise
Le terme survivologie a été introduit par David Manise, fondateur du CEETS (Centre d’Études et d’Enseignement des Techniques de Survie), pour distinguer sa démarche pédagogique et scientifique du simple « survivalisme », souvent teinté d’idéologie. Sénat
Pour moi « La Résilience », en tant qu’ex éducateur sportif et fasciné par cette discipline, la survivologie représente une approche raisonnée, pragmatique et humaniste de la survie. Elle met l’accent sur les savoirs, les compétences et l’éthique, plutôt que sur l’idéologie ou le sensationnalisme.
La F.O.S. : structurer et professionnaliser le secteur
Créée en mai 2021, la Fédération des Organismes de Survivologie (F.O.S.) réunit plusieurs écoles et formateurs de référence. Ses missions :
-
- proposer une charte éthique et déontologique,
- instaurer un cursus commun pour former les futurs moniteurs,
- contribuer à la reconnaissance de la discipline.
Le Diplôme fédéral de moniteur de survie (version 2022) comprend :
-
- un probatoire de 3 jours,
- 8 unités de formation (législation, pédagogie, prévention et secours, régulation thermique, alimentation, matériel, orientation, unités environnementales spécifiques),
- un examen final,
- un recyclage obligatoire tous les 5 ans.
Cette initiative permet de poser des standards privés dans un secteur encore peu encadré, mais elle n’a pas de valeur légale équivalente à un diplôme d’État.
Diplômes d’État vs. Moniteurs de survie
La situation pour les stages de survie est très différente des disciplines sportives encadrées par l’État :
-
Éducateurs sportifs diplômés d’État (BEES, DEJEPS…) : seuls autorisés à enseigner et encadrer contre rémunération certaines activités physiques. Leur diplôme garantit compétence, légitimité et assurance adaptée.
Pour les stages de survie
-
- Pas de diplôme d’État : il n’existe pas de certification officielle pour les moniteurs de survie.
- Activité non classée sport : un stage d’orientation, bivouac ou feu par friction est considéré comme une activité de loisir nature.
- Obligations légales : sécurité des participants, couverture assurance RC pro, compétence justifiable en cas de litige.
Exemples pratiques :
- Bivouac et purification de l’eau → pas besoin de diplôme d’État.
- Escalade, rappel ou activités aquatiques → diplôme d’État obligatoire.
La F.O.S. tente de combler cette zone grise avec un diplôme fédéral interne et des standards pédagogiques. Juridiquement, la valeur reste privée. En cas d’accident, c’est la compétence réelle de l’encadrant et les précautions prises qui seront examinées par le juge.
Le cadre légal aujourd’hui
À ce jour, il n’existe pas de réglementation spécifique aux stages de survie :
-
La réponse du ministère (question au Sénat, 2021) confirme l’absence de dispositif particulier.
-
Les obligations générales s’appliquent :
- Sécurité des participants (responsabilité civile et pénale)
- Assurance professionnelle
- Information claire sur les conditions et risques
- Respect du Code du sport ou du Code du tourisme, selon l’activité
- Formation de base aux premiers secours pour les encadrants
Des rapports de l’IGÉSR et de l’IGA alertent sur les risques liés aux encadrants peu formés et aux dérives idéologiques potentielles. La presse souligne également cette régulation floue, qui mêle structures très professionnelles et initiatives plus improvisées.
Conclusion
Le marché des stages de survie en France est aujourd’hui en plein essor et attire un public de plus en plus large.
-
- D’un côté, une demande motivée par la nature, l’aventure et la résilience personnelle.
- De l’autre, un vide juridique qui laisse le secteur dans une zone grise.
La création de la F.O.S. et la diffusion du terme survivologie marquent une tentative de structuration et de professionnalisation. Mais tant qu’aucun diplôme d’État ou cadre officiel n’existera, la vigilance reste indispensable — pour les encadrants comme pour les participants.
⚠️ Avant de s’inscrire, il est recommandé de vérifier la formation des instructeurs, leurs assurances et la philosophie de l’école. Après tout, survivre commence avant même le premier bivouac.

Je m’appelle Sébastien. Sans jugement ou catégorisation, je ne m’identifie pas plus particulièrement aux « Survivalistes », « Preppers », « Décroissant », (…) qui ont cependant le mérite de mettre en lumière des sujets et connaissances malgré tout. Je me reconnais plutôt comme un « Résilient ». En tant que père de famille, je développe une approche modéré, structurée et éducative avec une forte envie d’apprendre et transmettre. En savoir plus.