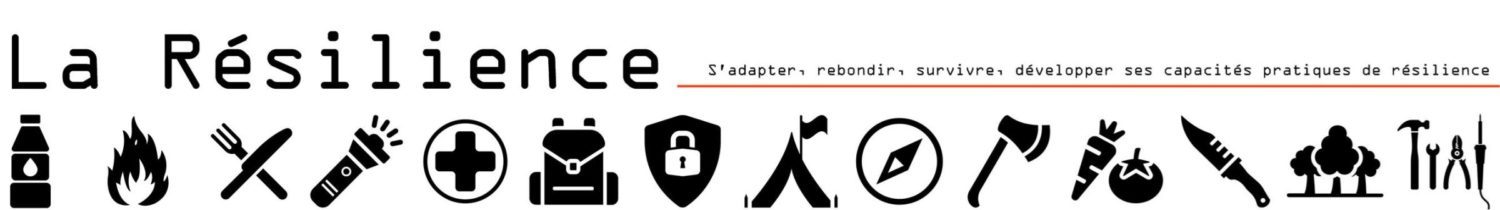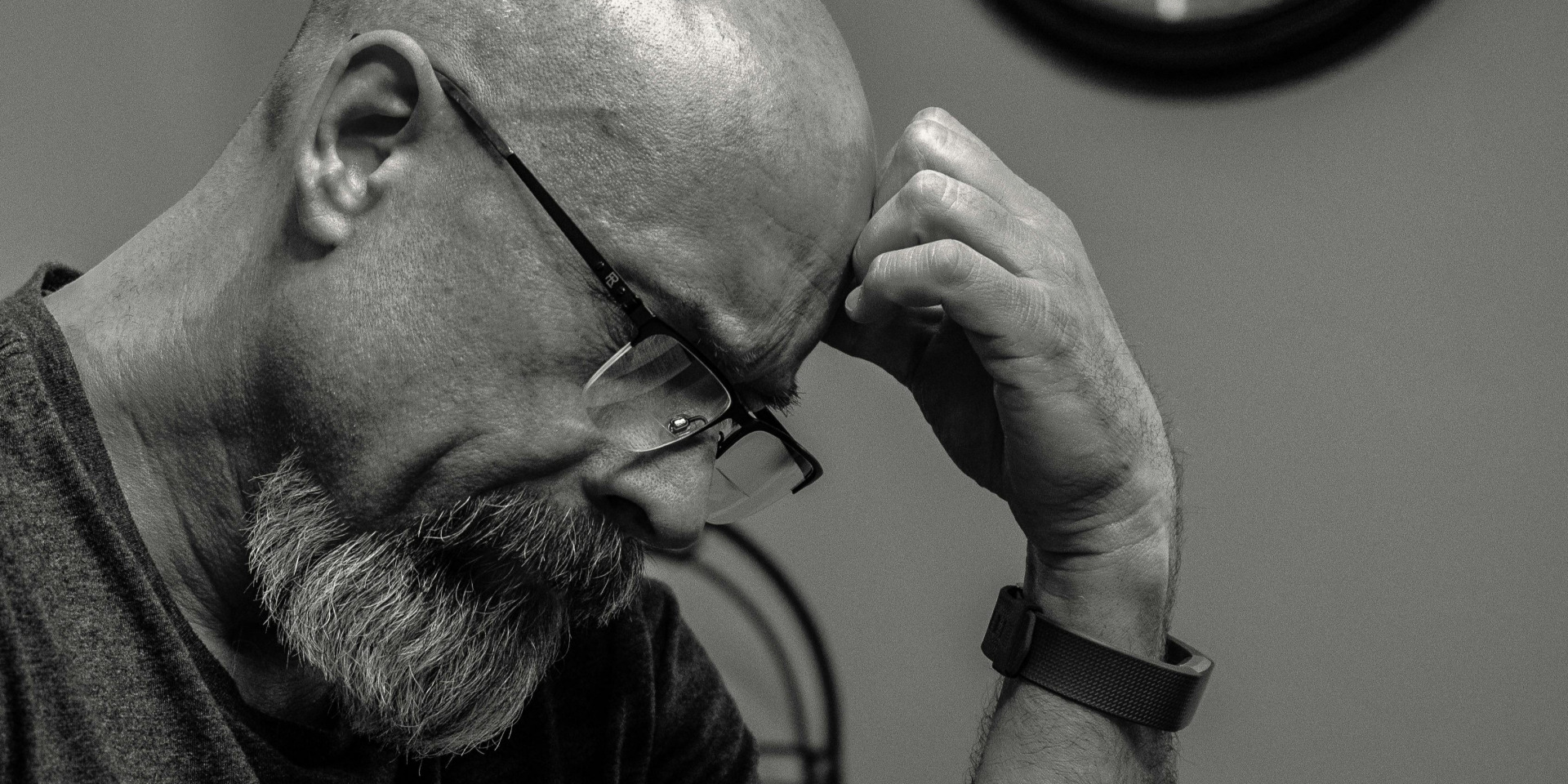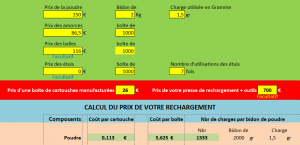Dans un monde où les crises se multiplient et se complexifient, qu’elles soient environnementales, comme les changements climatiques ou les catastrophes naturelles, économiques, avec les instabilités financières et les ruptures de chaînes logistiques, ou sociales, à travers la fragilisation des systèmes de solidarité et les tensions politiques, chacun se trouve confronté à une question essentielle : Comment anticiper, réagir et construire un avenir sûr et viable ?
Face à cette incertitude, différents courants de pensée ont émergé ces cinquante dernières années, proposant des réponses diverses pour s’adapter, se protéger ou transformer la société. Résilience, prepping, survivalisme, décroissance et collapsologie partent tous d’un constat partagé : Nos systèmes actuels sont vulnérables et exposés à des chocs majeurs. Mais la manière dont chacun interprète cette vulnérabilité, l’échelle d’action qu’il privilégie et les valeurs qu’il mobilise diffèrent profondément.
Certains choisissent de coopérer avec l’organisation existante, en s’appuyant sur leur capacité à gérer les crises et à soutenir les populations. D’autres préfèrent développer une autonomie radicale, en misant sur la préparation individuelle et familiale. Certains anticipent un futur transformable et cherchent à le construire, tandis que d’autres observent et s’adaptent à ce qui viendra, en acceptant les limites de ce qui peut être contrôlé.
Cet article se veut une réflexion analytique et transversale. Il ne se contente pas de dresser un inventaire de ces courants. Il cherche à décrypter leurs logiques, leurs visions et les choix qu’ils impliquent, en mettant en lumière les prismes qui permettent de comprendre pourquoi une même vulnérabilité peut donner naissance à des réponses radicalement différentes. L’objectif est d’offrir au lecteur une grille de lecture claire et nuancée, capable d’éclairer ses propres stratégies face aux crises et à l’incertitude.
1. Les origines et prismes des courants
Chaque courant de pensée possède une origine spécifique et un prisme particulier qui éclaire sa manière d’appréhender les crises et de proposer des solutions. Merci de considérer que l’état des lieux ci-dessous est l’expression de ma compréhension, et qu’il est probable que certains ne soient pas d’accord avec mes propos.
1.1 La résilience
La résilience, par exemple, puise ses racines dans la science. Initialement développée dans le champ de l’écologie par C.S. Holling dans les années 1970, elle a été progressivement adoptée en psychologie et dans les politiques publiques. Le prisme de la résilience est avant tout institutionnel et pragmatique : il s’agit de maintenir la continuité des systèmes face aux chocs, qu’il s’agisse d’infrastructures urbaines, de services essentiels ou de communautés. La résilience reflète donc un réalisme pratique : plutôt que de chercher à tout contrôler ou à se couper du système, elle invite à collaborer avec lui, à en comprendre les forces et à construire des marges d’adaptation.
1.2 Le prepping
Le prepping, historiquement ancré dans la culture américaine des années 1950-1970, est né d’une combinaison de préoccupations liées à la guerre froide, aux catastrophes naturelles et à une méfiance pragmatique face aux défaillances possibles des infrastructures publiques. Il met l’accent sur la prévoyance et la préparation matérielle, ainsi que sur la capacité de l’individu ou de la famille à faire face à des crises. Si certaines formes de prepping aux États-Unis ont pu être associées à des idées libertariennes ou à un certain scepticisme envers l’État, ce courant est en réalité très hétérogène : en Europe, il tend à se concentrer sur la logistique, les compétences pratiques et l’autonomie, sans qu’une orientation politique particulière soit systématiquement attachée. Le prisme du prepping reste donc avant tout individuel et pragmatique, centré sur la capacité à anticiper et à réagir.
1.3 Le survivalisme
Le survivalisme, qui s’est développé à partir des mêmes préoccupations que le prepping dans les années 1970 et 1980, accentue la dimension de préparation face aux situations extrêmes. Il peut inclure des compétences de survie, la maîtrise de la nature, la défense personnelle et l’expérience des armes à feu, mais il ne se réduit pas à une posture politique : si certains cercles l’ont systématiquement associé à des idéologies conservatrices ou sécuritaires, de nombreux survivalistes se concentrent simplement sur l’autonomie, la survie et la gestion pratique des crises. Le prisme dominant reste donc sécuritaire et autonome, orienté vers la préparation et la résilience individuelle voir clanique, sans qu’une affiliation politique stricte puisse être généralisée de nos jours.
1.4 La décroissance
La décroissance s’inscrit dans une critique politique et philosophique de la société de consommation et du productivisme, héritée des réflexions d’Illich, Gorz ou Latouche. Elle propose de réduire volontairement la production et la consommation afin de préserver les ressources naturelles et de favoriser la justice sociale. Le prisme de la décroissance est collectif et structurel : le problème est perçu comme systémique, et les réponses doivent passer par une transformation des règles économiques et sociales. Dans les mouvements contemporains liés à la décroissance, on observe parfois l’émergence de communautés ou de réseaux où les valeurs et comportements sont fortement normés, avec une tendance à l’auto‑sélection des membres partageant des visions « bienveillantes » ou « idéales ». Ces dynamiques, si elles peuvent renforcer la cohérence et la solidarité interne, comportent également le risque de créer un environnement très homogène et d’exclure les perspectives divergentes. Il s’agit toutefois d’un phénomène limité et non systématique, qui ne remet pas en cause l’esprit global de la décroissance, axé sur la sobriété volontaire, l’entraide et la transformation des modes de vie.
1.5 La collapsologie
La collapsologie se situe à l’intersection de la science et de la philosophie. Popularisée par Pablo Servigne et Raphaël Stevens, elle étudie les risques d’effondrement des sociétés industrielles à travers une approche transdisciplinaire, mobilisant l’écologie, l’économie, la sociologie et la physique des systèmes complexes. Son prisme est scientifique et écosystémique, avec une ouverture vers le collectif et la coopération. Si la collapsologie permet de définir des stratégies et des idéaux, comme la résilience communautaire, la relocalisation ou l’autonomie partielle, elle ne propose pas nécessairement de modèles concrets et directement applicables. Elle fournit surtout un cadre d’analyse et une philosophie de l’action face à l’incertitude, offrant des repères pour penser le futur, mais laissant souvent à chacun le soin de traduire ces idées en actions tangibles.
Chacun de ces courants propose donc une lecture distincte de la vulnérabilité : certains se concentrent sur l’individu, sa famille ou sa communauté immédiate, tandis que d’autres privilégient l’action collective ou institutionnelle. Les prismes choisis influencent non seulement les stratégies adoptées, mais aussi les valeurs mobilisées, la vision du futur et le rapport à l’État. Cette diversité illustre la richesse des réponses possibles face à un même constat : la fragilité de nos systèmes et la nécessité de se préparer à l’incertitude.
2. Le rapport à l’État : un triangle complexe
Durant la crise du Covid‑19, ce triangle a été particulièrement révélateur. Beaucoup de citoyens ont manifesté une forte confiance dans les capacités techniques de l’État, en s’appuyant sur les recommandations sanitaires, les mesures de confinement ou le déploiement de la vaccination. Dans le même temps, certains ont exprimé une méfiance vis‑à‑vis de l’assistanat, en questionnant l’efficacité de dispositifs comme le chômage partiel ou la distribution d’aides financières, et en recherchant des moyens de sécuriser eux‑mêmes leurs ressources et leur santé. Enfin, la perception du contrôle étatique a été très variable : pour certains, les mesures de confinement et le traçage des contacts ont été perçues comme nécessaires pour protéger la population, tandis que d’autres y ont vu un risque de surveillance accrue et une atteinte aux libertés individuelles.
Le rapport à l’État ne se réduit pas à une simple opposition entre confiance et méfiance. Il s’agit d’une relation complexe, qui peut se décomposer en trois dimensions distinctes mais interconnectées : la confiance dans la capacité de l’État, la dépendance ou l’assistanat et le contrôle ou la surveillance. Chacun des cinq courants de pensée « résilience, prepping, survivalisme, décroissance et collapsologie » se positionne différemment selon ces dimensions, révélant leurs logiques, leurs priorités et leurs valeurs.
La confiance dans l’État renvoie à la croyance en sa capacité à protéger les citoyens, à gérer les crises et à maintenir la continuité des infrastructures essentielles. La résilience, par exemple, s’appuie en partie sur cette confiance. Les politiques publiques, les dispositifs de protection civile et les stratégies urbaines de résilience supposent que l’État a les moyens techniques et humains pour organiser la réponse face aux crises. De manière générale, cette dimension traduit une vision pragmatique, où l’État est un partenaire capable de soutenir l’adaptation collective.
La dimension de dépendance ou d’assistanat correspond à l’attente que l’État prenne en charge directement les solutions, qu’il s’agisse d’aides sociales, de stocks stratégiques ou de dispositifs logistiques. Dans certains contextes, cela peut engendrer une passivité ou une réduction de l’autonomie individuelle. Les courants de prepping et de survivalisme, tout en reconnaissant parfois la valeur des institutions, tendent à minimiser cette dépendance. Ils privilégient l’initiative personnelle et la préparation autonome, qu’il s’agisse de constituer des réserves, d’acquérir des compétences techniques ou de s’organiser en petits groupes.
Le troisième angle, celui du contrôle et de la surveillance, renvoie à la perception que l’État peut exercer une autorité coercitive lors des crises, que ce soit par le rationnement, la réglementation stricte ou la limitation des libertés. Certains survivalistes voient cette dimension comme une menace potentielle, ce qui renforce leur volonté d’indépendance. À l’inverse, la décroissance et la collapsologie, tout en restant critiques vis-à-vis des institutions actuelles, considèrent plutôt ces dispositifs sous l’angle de leur efficacité collective. Ils cherchent à transformer ou à compléter le rôle de l’État plutôt qu’à le fuir totalement.
Ainsi, le rapport à l’État ne peut se réduire à un simple axe confiance/méfiance. Il s’agit plutôt d’un triangle complexe, où la confiance, la dépendance et le contrôle interagissent pour définir la posture de chaque courant face à la société et aux crises. Comprendre ce triangle permet de saisir pourquoi certaines approches privilégient la coopération avec les institutions, d’autres l’autonomie individuelle et d’autres encore la transformation collective. Cette lecture fine évite les raccourcis simplistes et éclaire la diversité des stratégies possibles face à un même constat de vulnérabilité.
Le patriotisme : un prisme supplémentaire
Au-delà de la confiance, de la dépendance et du contrôle, le rapport à l’État peut également être influencé par le patriotisme, entendu comme l’attachement à la nation, à ses institutions (pas la politique), à ses valeurs et à ses territoires. Ce prisme ajoute une dimension identitaire et culturelle à l’analyse, car il façonne la manière dont chaque courant de pensée se positionne face à l’État et aux crises.
Dans le courant de la résilience, le patriotisme se manifeste souvent par un soutien implicite aux institutions et aux politiques publiques. L’État et ses dispositifs sont perçus comme des garants de la sécurité collective et de la cohésion nationale. Cette loyauté contribue à renforcer la coopération avec les collectivités et à intégrer la résilience dans des stratégies institutionnelles.
Chez les preppers, le patriotisme peut coexister avec une forte valorisation de l’autonomie individuelle. Il s’exprime davantage par un attachement à la nation et à ses libertés qu’à l’État central, ce qui justifie la préparation personnelle et la constitution de ressources indépendantes. Le prepping illustre ainsi un patriotisme pragmatique, qui combine loyauté symbolique et responsabilité personnelle.
Le survivalisme, surtout dans ses formes les plus radicales, peut également intégrer une dimension patriotique. Cependant, celle-ci est souvent sélective et tournée vers la protection du territoire et de la communauté de référence plutôt que vers les institutions centrales. Cette vision renforce la méfiance envers un État perçu comme potentiellement incapable ou coercitif en période de crise.
Pour la décroissance et la collapsologie, le patriotisme n’est pas un moteur central. Ces courants sont souvent peu attachés à la nation au sens classique et peuvent se montrer critiques vis-à-vis des symboles étatiques et des institutions militaires. Leur engagement se situe plutôt au niveau des communautés locales, des écosystèmes et des solidarités de proximité. L’accent est mis sur la pérennité des liens humains et naturels plutôt que sur le respect ou la défense de l’État. Cette posture traduit une vision anti-militariste et critique des structures de pouvoir centralisées, privilégiant l’autonomie collective et la coopération sur le terrain.
En résumé, le patriotisme ajoute une couche identitaire au triangle État-confiance-dépendance-contrôle. Il montre que l’attachement à la nation ou au territoire peut coexister avec des logiques d’autonomie ou de coopération, et qu’il influence subtilement les stratégies et comportements de chaque courant face aux crises. Comprendre cette dimension permet de nuancer encore davantage l’analyse du rapport entre citoyens et institutions.
3. La perception de l’État face aux différents courants
Chaque courant de pensée ne se contente pas de se positionner vis-à-vis de l’État, l’État lui-même porte un regard spécifique sur ces mouvements. Ces perceptions dépendent à la fois de l’ampleur, de la visibilité et du degré de radicalité supposée de chaque courant.
- La résilience, parce qu’elle est souvent intégrée dans les politiques publiques et les dispositifs institutionnels, est généralement bien perçue par l’État. Elle correspond à un objectif partagé : anticiper et gérer les crises pour minimiser les impacts sur la société. L’État voit dans la résilience une manière de renforcer l’efficacité de ses programmes et de favoriser la coopération avec les citoyens et les collectivités. Cette perception est favorable car elle s’aligne avec les missions institutionnelles et ne remet pas en question le système.
- Le prepping, en revanche, peut susciter une perception plus nuancée. Pour l’État, il s’agit d’un mouvement souvent privé et individualiste, qui n’est pas directement coordonné avec les institutions. Tant que le prepping reste centré sur la préparation matérielle et les compétences de base, il est perçu comme neutre ou même bénéfique, car il réduit la dépendance aux services publics lors de crises ponctuelles. Toutefois, lorsque certaines pratiques impliquent l’armement ou une méfiance marquée envers l’État, le prepping peut être observé avec prudence.
- Le survivalisme, surtout dans ses formes les plus radicales, est perçu par l’État avec davantage de vigilance. La préparation à des situations extrêmes, le repli sur des groupes fermés ou la valorisation de l’autosuffisance armée peuvent être interprétés comme des défis potentiels à l’ordre public ou à la cohésion sociale. Cela ne signifie pas que l’ensemble du mouvement est stigmatisé, mais l’État surveille souvent les manifestations les plus visibles ou militantes pour anticiper des tensions éventuelles.
- La décroissance, en tant que critique du système économique et promoteur de modes de vie alternatifs, est perçue de manière diverse selon les contextes. L’État peut accueillir favorablement certaines initiatives locales ou expérimentations de sobriété et de relocalisation, qui s’insèrent dans des politiques de développement durable. En revanche, les mouvements de décroissance plus radicaux ou fortement normatifs peuvent être vus comme éloignés de l’agenda économique dominant, suscitant parfois une certaine méfiance institutionnelle.
- La collapsologie, enfin, est en général perçue comme une réflexion intellectuelle ou scientifique. Les experts et décideurs peuvent la considérer utile pour anticiper des risques systémiques, identifier des vulnérabilités et encourager la préparation collective. Néanmoins, comme elle ne fournit pas toujours de solutions concrètes et repose sur des constats prospectifs parfois alarmistes, certains responsables peuvent la juger abstraite ou difficile à traduire en politiques opérationnelles.
Dans l’ensemble, la perception de l’État oscille entre reconnaissance de l’utilité et prudence face aux risques de déconnexion ou de radicalisation. Elle est autant une question de contenu et de forme des pratiques que de leur impact sur l’ordre public et la société. Comprendre cette perception réciproque, côté citoyens et côté institutions, permet de mieux analyser les dynamiques et les tensions qui traversent les réponses aux crises.
4. Faire avec le système : une forme de réalisme
Dans ma propre approche, je comprends la résilience comme la capacité à faire avec la normalité existante plutôt que de s’y opposer. Il ne s’agit pas d’un alignement passif sur le système, mais d’une manière pragmatique de tirer parti de ses forces, qu’il s’agisse des infrastructures, des services ou des savoir-faire disponibles. Même en recherchant une autonomie personnelle, l’individu reste dépendant de chaînes complexes : alimentation, énergie, santé, information. Reconnaître cette interdépendance me semble être une manière réaliste de concevoir des stratégies efficaces.
Adopter cette posture dans la vie quotidienne favorise une capacité d’adaptation qui devient précieuse en situation de crise. Cela n’exclut pas la préparation personnelle : constituer des réserves, acquérir des compétences ou anticiper certains risques reste pertinent. Mon objectif est de compléter et renforcer la normalité plutôt que de la fuir, en développant des marges de manœuvre tout en restant connecté aux dynamiques collectives.
À ce titre, contribuer à l’effort collectif me paraît essentiel. Participer aux initiatives locales, partager des compétences, coopérer avec ses voisins ou sa communauté renforce non seulement la sécurité individuelle, mais aussi la résilience de tous.
Cette approche contraste moins frontalement avec le prepping ou le survivalisme. Elle s’en distingue surtout par le degré d’autonomie recherchée et par la manière de se projeter : là où certaines pratiques misent sur une anticipation très poussée et une préparation autonome, faire avec la normalité consiste, selon moi, à s’appuyer sur le système existant tout en préparant des marges de sécurité et de flexibilité personnelles, tout en restant un acteur engagé du collectif.
5. Réflexion
L’analyse des cinq courants de pensée permet de dégager plusieurs enseignements clés pour comprendre la diversité des réponses face aux crises et aux risques systémiques.
Tout d’abord, le même constat : la vulnérabilité du système actuel peut générer des réponses très différentes. Selon les individus et les groupes, il peut s’agir de stratégies individuelles, communautaires, pragmatiques, politique ou utopiques. Comprendre ces divergences nécessite de prendre en compte la temporalité et l’échelle d’action : certaines approches privilégient la prévention tandis que d’autres sont centrées sur la réaction, certaines agissent sur le système dans son ensemble alors que d’autres se concentrent sur le foyer ou le territoire local.
Le rapport à l’État est également complexe et nuancé. Distinguer confiance, dépendance et contrôle permet d’expliquer pourquoi certains privilégient la coopération, d’autres l’autonomie, et d’autres encore la transformation des institutions. Ces choix sont rarement binaires et dépendent autant de convictions politiques que de perceptions pratiques.
Les valeurs sous-jacentes orientent les comportements et les priorités. Selon les courants, il peut s’agir de l’autonomie, de la solidarité, de la sécurité, de la sobriété ou de l’innovation. Ces valeurs donnent une cohérence aux stratégies choisies et permettent de comprendre la logique derrière chaque approche.
Enfin, il est important de souligner la possibilité d’hybridation. Un individu ou un groupe peut combiner plusieurs logiques : chercher à être autonome tout en coopérant avec le système, anticiper les crises tout en développant des capacités d’adaptation, ou encore allier pragmatisme et idéal. Cette flexibilité souligne que ces courants ne sont pas des catégories figées mais des référentiels en mutation, utiles pour réfléchir à des réponses éclairées face à la vulnérabilité du système.
6. Ma conclusion
Vous l’avez probablement senti tout au long de cet article : mon approche est modérée, pragmatique et réaliste. Je ne cherche pas à inscrire ces réflexions dans un cadre politique précis. À 56 ans, j’ai tendance à écouter les autres sans nécessairement adhérer à leur propos. Prenez le temps d’écouter et comprendre vos enfants, car le regard que l’on porte sur le monde à 20 ans est souvent très différent de celui que l’on adopte avec l’expérience et la maturité.
Pour autant, si je devais situer ma propre posture parmi les courants analysés, je me sens plus proche d’une combinaison des prismes résilience et survivalisme. Cela signifie que je valorise la capacité à faire avec la normalité existante, à anticiper certaines crises, à développer des marges de manœuvre personnelles, tout en restant un acteur engagé du collectif et en contribuant à l’effort commun.
Cette position reflète pour moi un équilibre : ne pas se fermer aux dynamiques collectives, tout en gardant une autonomie pragmatique, capable d’absorber les chocs et de s’adapter aux évolutions de notre environnement. C’est une démarche réaliste, qui reconnaît la vulnérabilité du système tout en cherchant à tirer parti de ses forces et à participer à sa transformation, sans tomber dans le militantisme radical ou la préparation extrême.
A l’occasion allez relire mon article de 2019 : La mutation : Résilient, Néosurvivaliste, Survivaliste, Prepper …

Je m’appelle Sébastien. Sans jugement ou catégorisation, je ne m’identifie pas plus particulièrement aux « Survivalistes », « Preppers », « Décroissant », (…) qui ont cependant le mérite de mettre en lumière des sujets et connaissances malgré tout. Je me reconnais plutôt comme un « Résilient ». En tant que père de famille, je développe une approche modéré, structurée et éducative avec une forte envie d’apprendre et transmettre. En savoir plus.